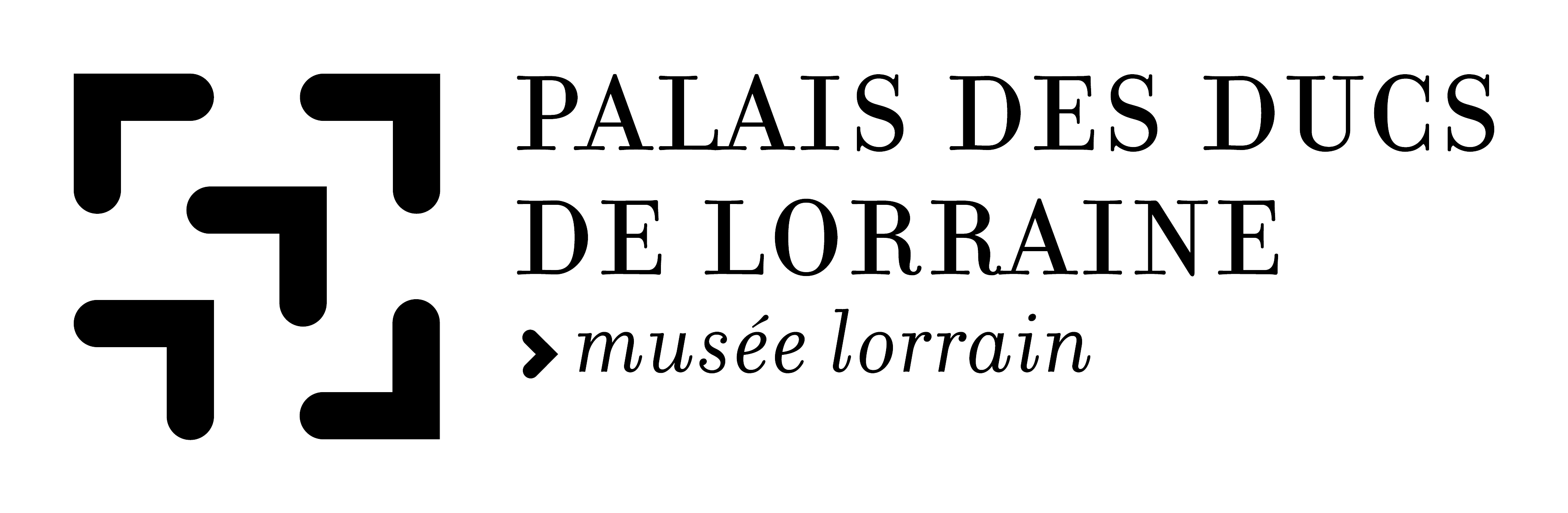L'histoire des collections
Riche de plus de 155000 pièces, tous domaines confondus, la collection du musée couvre tout l’espace lorrain et embrasse l’histoire de la région depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine.
Dans un premier temps, la collection du musée comprend essentiellement les « antiquités » recueillies dans la première moitié du XIXe siècle par la commission des Antiquités de la Meurthe. Progressivement, la collection s’enrichit de sculptures, de portraits historiques, de gravures et d’objets d’art, la plupart du temps offerts par de généreux donateurs. Malheureusement, ce premier ensemble est considérablement endommagé par l’incendie qui ravage le site en 1871. Au lendemain du sinistre, il faut reconstituer les ensembles disparus. Le défi est gigantesque mais brillamment relevé : le catalogue, qui comptait 1415 numéros en 1869, en compte près de 3000 en 1895 ! Durant cette période, des pièces majeures intègrent la collection, comme le manuscrit de La Nancéide par Pierre de Blarru, le lit du duc Antoine, le Hanap de Sion, ou encore le service en faïence aux armes de Léopold et d’Elisabeth-Charlotte. Le rythme des acquisitions et des collectes s’intensifie encore en 1910 avec la création de la section des arts et traditions populaires, alors qualifiés d’arts « rustiques ».
Plusieurs collections lorraines prestigieuses font leur entrée au musée dans l’entre-deux guerres : celle de la famille Thiéry-Solet (1921), qui inclut les cuivres de Jacques Callot, celle de Louis Edme-Gaucher (1928), ou encore celle de Lucien et René Wiener (1939). Des dépôts viennent compléter le fonds : c’est ainsi que l’Institut de France dépose au musée les globes terrestre et céleste de Jean L’Hoste, exécutés pour le duc de Lorraine Henri II au début du XVIIe siècle.
Après la Seconde Guerre mondiale, d’importants legs sont consentis en faveur du musée par de généreux donateurs : Georges Goury (1955), Eugène Corbin (1956), Henri Marcus (1966), René Cadet (1966), Edouard et Suzanne Salin (1975). Leur générosité contribue à enrichir les collections dans les domaines de l’archéologie, des arts décoratifs et de la peinture. C’est aussi après-guerre que la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain acquiert La Femme à la puce, chef d’œuvre de Georges de La Tour devenue icône du musée.
À partir des années 2000, la Ville de Nancy s’engage aux côtés de la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain afin de poursuivre la politique d’acquisition d’œuvres : en 2009, elle acquiert le trésor de Pouilly, chef d’œuvre d’orfèvrerie de la Renaissance. En 2017, c’est au tour de l’épée de Grand Ecuyer de Lorraine, classée Trésor national, d’intégrer les collections du musée. L’archéologie n’est pas oubliée, ainsi qu’en témoigne l’acquisition de la lance d’apparat de Cutry en 2018. Également partenaires du projet de rénovation du musée, l’État, la Région Grand Est et la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain sont étroitement associés à ces enrichissements.